« Dans cette ombre, il y a une jeune fille de dix-huit ans, portant une veste de sécurité. Les yeux baissés, elle remonte de Monastiraki à la place du Parlement. Elle traîne de sa main gauche un grand sac et, de la droite, elle vide les poubelles. Les éboueuses sont lycéennes. »
Par Léonard Vincent, auteur du roman "Athènes ne donne rien" (Equateurs, 2014).
Depuis deux jours, un orage sombre fait son apparition par moments dans le ciel poussiéreux d’Athènes, puis disparaît. D’épais nuages noirs masquent le soleil quelques secondes. Les rues s’éteignent. Les gens se taisent. Quelques gouttes piquent les crânes des passants, mais ce sont les exhalaisons des climatiseurs accrochés aux fenêtres. Dans les bureaux et les hôtels, ils assèchent froidement la moiteur de l’immense capitale affairée. Mais soudain, le soleil reprend son trône. Le béton vire au jaune de nouveau, les visages cuisent, la fine poussière de la pollution s’élève jusqu’aux narines. Athènes brûle comme d’habitude.
Les gens d’ici marchent vers des tâches quotidiennes. Les voitures sont modernes, les motos pétaradent. Mais les apparences sont trompeuses. Il y a ceux qui travaillent et puis ceux qui ne sont plus là. On cherche les disparus, qui se cachent dans les appartements vides ou les foyers de la misère. La cité tourne sans eux. En quelques années, la capitale de la Grèce est devenue misérable, au-delà des marbres et des jardins aux oiseaux, au-delà des boyaux à souvenirs, au-delà de la joviale bourgeoisie européenne qui continue de faire comme si de rien n’était : à deux ou trois stations de métro, des quartiers entiers se sont vidés et un petit peuple errant, la peau brûlée, les bras secs comme ceux des momies, se cache sous les porches et tend la main.
Plus une boutique ouverte. Partout, des rideaux de fer tatoués de graffitis, des affiches rouges, des magasins abandonnés aux détritus, des autocollants « à vendre, à louer » placardés là depuis des mois, en vain. La crise de 29 ne devait pas ressembler à autre chose. Les hommes devaient toujours porter une cravate. On a dû seulement y croiser dans les rues, comme ici, plus de friches inquiétantes, plus de pièces vides où le courrier s’entasse, plus de policiers lourdement armés, plus de fouilleurs de déchets, plus de venelles fantômes, plus de silence et de crasse, plus de fous qui parlent tout seuls dans les passages, ou alors avec les chats. Non, ce n’est pas grand-chose, après tout. Ça ne se voit pas, ou presque pas. Il n’y a que des traces, des signes, « un vide sous le masque ». L’oppression, ce sont des rues négligées et des citoyens absents.
Athènes est ainsi. L’aéroport Eleftherios Venizelos, les grandes lignes du métro, la rue Ermou où sont alignées les boutiques aux noms imbéciles, tout est propre et lisse, avec un marbre de mauvais goût et la rumeur d’une radio aux accents américains. Les femmes y défilent, un gobelet de carton dans la main. Les hommes ont enchâssé leur visage de leur plus épouvantable paire de lunettes. La police dort aux terrasses de café. Mais c’est dans l’ombre qu’il faut chercher la crise.
Dans cette ombre, il y a une jeune fille de dix-huit ans, portant une veste de sécurité. Les yeux baissés, elle remonte de Monastiraki à la place du Parlement. Elle traîne de sa main gauche un grand sac et, de la droite, elle vide les poubelles. Les éboueuses sont lycéennes.
Un an après, je suis retourné à Athènes, pour éveiller une foule de fantômes, passer sous nos portiques anciens, zigzaguer entre les conteneurs, respirer les motos, m’éblouir de lumière, m’accorder à notre mer commune et diagnostiquer l’oppression, qui est là, entre le Parlement et les terrains vagues de la plaine venteuse de l’Attique, qui nous attend, nous et tout ce que nous avons à cacher et à chérir.
« La crise, c’est comme la peste. Chaque jour, on apprend qu’untel a été licencié, comme ça, par hasard. On en entend parler, sans trop y croire. Un jour, c’est dans ta propre famille. Le lendemain, c’est ta femme. Aujourd’hui, c’est moi. J’ai plus de cinquante ans, je ne trouverai plus jamais de travail. Le futur est noir. » Ainsi parle Dimitris, premier alto de l’orchestre symphonique de la radiotélévision publique.
À la périphérie de cette sombre comédie en plein soleil, des quartiers entiers ont été laissés aux plus offrants. Autour de la place Omonia, on parle Tamoul et Ourdou et Mandarin. Shalimar Islamic Commodities, au coin de la rue Sophocle et de la rue Euripide. Là-haut, au bout de la rue des Vents, l’Acropole ne dit rien encore : elle attend de se réveiller pour l’ultime foudroiement. Ou bien elle a abdiqué, reine déchue, nue et humiliée sur son rocher mangé aux mites. À ses pieds, l’antique cimetière aux stèles blanches de Keramikos s’est répandu jusque sur les façades des petites maisons. La mort a gangréné les venelles aux orangers. Des junkies se piquent dans l’alcôve des porches abandonnés. Les tavernes ont été laissées aux cafards, gros comme des pruneaux, qui parcourent la ville à la recherche de miettes bienfaisantes. Les épiceries gorgées d’olives et de fromage ont désormais des noms suédois et, là où les Grecs ont fui, des commerçants chinois ont levé le rideau de fer sur du gros et du demi-gros, en fumant une cigarette. Hilares, joufflus, les enfants de Lu Chua s’amusent à faire rouler une orange sur le bitume de la rue Sapphô, à un coup-franc du dispensaire de Médecins du monde où se pressent les Afghans terrorisés, chats maigres et hirsutes fuyant les hyènes qui font la loi dans les rues.
Car la nuit, dans le petit quartier oublié d’Amerikis, les motards d’Aube dorée affûtent leur chicotte. Les Africains qui s’ennuient les guettent avec précaution avant de tourner le coin de la rue, ils les jaugent, eux et tous ceux qui portent un uniforme. Là où l’État grec a fondu, comme une petite mare d’eau salée qui s’est évaporée au creux d’une pierre, il a laissé un résidu pestilentiel d’algues pourries. Les mafias sont devenues les maîtresses des interstices. Portiers de boîtes de nuit, rabatteurs de sex-shops et gardes-du-corps imposent les règles des défilés aux flambeaux, au profit de députés portant des chevalières et des croix ambiguës. Les comptables des grandes banques leur ont offert les quartiers destitués et les tablées sous les arcades, où résonnent maintenant leurs talkies-walkies.
Mais la grande ville blanche gronde, malgré les Perses qui campent aux lisières, malgré les barbares de Sylla qui ont déjà pillé les alentours. Des hauteurs, on voit que chaque immeuble montre fièrement son visage au ciel vide, offre encore ses toits ouverts aux claquements du linge et aux cinémas clandestins. Aux enseignes tatouées par un alphabet de linteaux et de métopes, pendent déjà les frusques des vaincus. Mais les Athéniens en ont vus d’autres, et des plus féroces. La capitale des Grecs est somptueuse parce qu’elle boîte, les yeux blessés, errant dans l’Europe cruelle une canne de roseau dans la main et un enfant dévoué à son côté. Dans Exarchia la rouge, des gamins aux cheveux d’encre dessinent la révolte sur les affiches, avec des étoiles et des poings. Parmi les tablées des ouzéris, dans les passages, dans les traverses, sous les rangées d’ampoules emmêlées dans les feuilles des arbres, les vieux chanteurs sonnent l’appel aux partisans, un bouzouki sur le dos. Les chats dorment pour nous. Les cigales se taisent pour nous. Le soleil éclate derrière le mont Pentélique, tous les soirs pour nous. À l’extinction des feux, on s’arrête dans les escaliers sous l’Acropole. « Mauvais témoins sont les yeux et les oreilles des hommes dont l’âme est barbare », nous a prévenu Héraclite.
La paille couchée, les pierres, les murs écroulés. On attend que le rocher là-haut commence. La nuit tombe comme on agonise au théâtre et les pentes s’imprègnent de lumière. Humide et tiède, l’éponge du soir est peuplée de moucherons. Le ciel mauve rend un dernier souffle. Les bouteilles sont vides, les chats maigres et hallucinés. Les lampadaires éclosent et avec eux les guirlandes. Tout respire, sauf les hommes. On espère la catastrophe qui mettra fin au temps linéaire. L’Acropole est faite d’émeraudes enchevêtrées. Médée se maquille pour la nuit.
Athènes
26 Juin-3 juillet 2013








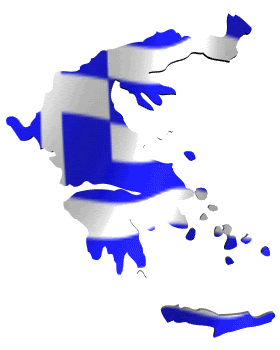



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου